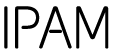Le paradigme écologique et le politique
Le paradigme écologique et le politique
12 avril 2014
L’écologie s’est imposée comme un nouveau paradigme. Ce paradigme modifie la pensée de l’émancipation et renouvelle la pensée de la transition. Dans cette contribution, nous voudrions avancer quelques réflexions autour de quatre entrées : penser la situation, ses contradictions et la nature de la crise en tant que crise de civilisation ; penser le monde à travers les débats écologistes ; penser la transition, à partir des avenirs possibles ; penser le politique, la culture politique et le rapport au politique.
Penser la situation
Pour penser la situation, il faut prendre conscience du rôle central de la dimension écologique dans la crise globale. Pour définir la situation, il faut partir des grandes contradictions qui sont à l’œuvre. La crise structurelle articule quatre dimensions : économique et sociale, celle des inégalités sociales et de la précarisation ; idéologique, avec l’interpellation de la démocratie, l’idéologie sécuritaire, les poussées xénophobes et racistes, la corruption qui résulte de la fusion de la classe financière et de la classe politique ; géopolitique, avec la fin de l’hégémonie des États-Unis, la crise du Japon et de l’Europe et la montée de nouvelles puissances ; écologique, avec la mise en danger de l’écosystème planétaire. La crise écologique est la dernière arrivée. Comme l’a explicité Fernand Braudel, l’organisation du monde est entrée en contradiction avec l’écosystème planétaire ; et c’est la première fois dans l’histoire de l’humanité.
Dans chacune des crises particulières qui marquent les déclinaisons de la crise globale, les implications de l’écologie sont considérables. Ainsi des crises financière, boursière, économique, alimentaire, de l’emploi, énergétique, climatique, immobilière, etc. La dimension écologique joue un rôle dans la genèse et l’approfondissement de la crise globale. La crise écologique mondiale est devenue patente. Il s’agit autant de l’aggravation de la crise écologique que de la prise de conscience de cette dimension. L’écologie fonctionne comme un paradigme nouveau qui introduit de nouveaux aiguillages dans la manière de penser le monde. Chacune des dimensions de la crise doit être appréciée dans son rapport à l’écologie. L’écologie interdit d’envisager une issue à la crise économique et sociale qui reprendrait le modèle dominant de la croissance et du productivisme. Elle redessine les équilibres géopolitiques déjà confrontés au rééquilibrage économique introduit par les pays émergents ; elle définit les nouveaux enjeux mondiaux dans la crise climatique et l’accès aux ressources naturelles.
La réciproque est aussi vraie. Ainsi, la relation avec la dimension économique et sociale de la crise induit la nécessité de prendre en compte les inégalités écologiques et les inégalités sociales ; de lier écologie et social et de reconnaître que la crise écologique est une crise sociale. Ainsi, la relation avec la crise politique et écologique induit la nécessité de prendre en compte les insécurités croissantes, les dérives autoritaires, la remise en cause des droits fondamentaux et des droits environnementaux ; de lier écologie et libertés. Ainsi, la relation avec la crise géopolitique induit la nécessité de prendre en compte les risques de conflits et de guerres et les inégalités entre les pays ; de lier écologie et solidarité internationale.
La compréhension de l’écologie dans le contexte actuel ne peut être envisagée en dehors des autres dimensions de la crise. C’est ce qui caractérise la différence entre les réponses écologiques. Les premières caractérisations, et différenciations, des réponses et des politiques écologiques se définissent dans la manière de lier écologie et social, écologie et libertés, écologie et solidarité internationale.
L’écologie joue un rôle majeur dans l’hypothèse d’une crise structurelle du capitalisme. Celle-ci résulterait de l’épuisement de la financiarisation néolibérale en tant que phase de la mondialisation capitaliste ; de la crise de l’hégémonie des États-Unis et de l’Europe et de la géopolitique occidentale ; de la crise écologique. Comme l’ont affirmé les mouvements présents au FSM de Belém, en 2009, il s’agit en fait d’une triple crise emboîtée : une crise du néolibéralisme en tant que phase de la mondialisation capitaliste ; une crise du système capitaliste lui-même qui combine la contradiction spécifique du mode de production, celle entre capital et travail, celle entre les modes de la production et les modes de la consommation et celle entre les modes productivistes et les contraintes de l’écosystème planétaire ; une crise de civilisation qui découle de l’interpellation des rapports entre l’espèce humaine et la Nature qui ont défini la modernité occidentale et qui ont marqué certains des fondements de la science contemporaine.
L’écologie intervient à chacun des niveaux de cette triple crise. Elle limite les sorties classiques de la crise du néolibéralisme en introduisant des limites à la croissance et à l’élargissement du marché illimité. Elle éclaire la crise du système capitaliste en interpellant la production, la consommation et leurs rapports. Elle met les rapports avec la Nature au centre de la crise civilisationnelle.
Penser le monde
L’écologie fonctionne comme un paradigme nouveau qui introduit de nouveaux aiguillages dans la manière de penser le monde. Parmi les débats qui ont pris de nouvelles formes, on peut citer le débat scientifique.
Le débat international sur l’écologie a déjà une histoire. En 1968, le Club de Rome prépare un rapport qui sera publié en 1972 par le Massachussetts Institute of Technology (MIT) sur l’épuisement des ressources non renouvelables. Ce rapport est instrumentalisé dans un débat fortement marqué idéologiquement dans la période de la crise de la décolonisation. Cette approche attribue à la croissance démographique du Sud – la « bombe P » (pour population) – la responsabilité de la crise écologique annoncée. Au début des années 1970, le mouvement écologiste devient de plus en plus visible, avec notamment, en 1971, la création de Greenpeace et la transformation des Amis de la Terre (qui existent depuis 1958) en Fédération Internationale de « Friends of the Earth ». En France, en 1974, le premier candidat écologiste à une élection présidentielle, René Dumont, est emblématique de la liaison entre l’écologie émergente et l’impératif de la solidarité internationale. C’est aussi en 1974 qu’André Gorz publie dans Les Temps Modernes « Leur écologie et la nôtre ».
En 1976, à Vancouver, la Conférence internationale des Nations unies sur l’habitat humain propose la promotion de la durabilité écologique et sociale des villes. En 1983, les Nations unies créent la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, présidée par Gro Brundtland. La commission formalise la notion de sustainable development, traduit en français par « développement durable ». Ses recommandations ont conduit à la convocation, en 1992 à Rio de Janeiro, du Sommet de la Terre, ou Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED).
C’est à partir du sommet de Rio que s’est noué le débat public sur l’évolution de la pensée scientifique. Au début de la conférence, des scientifiques de renom ont publié un « Appel de Heidelberg », dans lequel ils déclaraient s’inquiéter de « l’émergence d’une idéologie irrationnelle qui s’oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement économique et social » et affirmaient que « l’état de nature, parfois idéalisé par des mouvements qui ont tendance à se référer au passé, n’existe pas et n’a probablement jamais existé depuis l’apparition de l’homme dans la biosphère, dans la mesure où l’humanité a toujours progressé en mettant la nature à son service et non l’inverse ». De nombreux scientifiques, liés aux mouvements sociaux et citoyens, ont réagi avec vigueur, notamment dans l’« Appel à la raison pour une solidarité planétaire » lancé par l’association de scientifiques et d’experts Global Chance, contre cette conception datée du progrès conçu comme l’alliance entre la science et l’industrie, et portée par les « comportements d’impérialisme scientifique qui prétendent sauver l’humanité par les seules science et industrie ». Ce débat continue aujourd’hui autour de l’urgence climatique et/ou de la responsabilité des activités humaines dans cette évolution.
Pendant ce temps, des changements font leur chemin, déterminant le très long terme. Parmi ces changements, il faut noter, à travers la crise, les extraordinaires bouleversements scientifiques et techniques, particulièrement dans le numérique et les biotechnologies. La science qui a pu porter la libération contre les pouvoirs établis a été domestiquée par la marchandisation qui devient son horizon. Une large part des scientifiques a été associée au pouvoir et intégrée dans l’oligarchie des financiers, des politiques et des militaires. Les scientifiques servent de caution pour la référence au progrès et à la modernité. Toute remise en cause de ces certitudes qui éliminent le doute est taxée d’obscurantisme. La folie du possible sans limites devient le droit pour les entreprises, avec la caution des scientifiques, de ne prendre aucune précaution ; de se parer du refus des limites des scientifiques pour légitimer le refus des limites des profits. La révolution culturelle portée par l’écologie exacerbe l’affrontement entre les possibilités ; celles de la domestication de ce progrès au service de l’exploitation et de l’aliénation ou celles de nouvelles ouvertures au service de l’émancipation.
La crise climatique n’est pas la seule dimension de la crise écologique, même si elle est aujourd’hui première. L’écologie est au centre des débats dans tous les continents. Progressivement, tous les thèmes des approches écologistes prennent leur importance : les ressources en eau et la pollution des fleuves ; les ressources énergétiques et minières ; les sols et la déforestation ; le climat ; l’environnement urbain ; les installations industrielles ; les déchets. La discussion plus générale s’est engagée sur les rapports avec la Nature. La montée en puissance et en visibilité des mouvements des peuples indigènes a joué un grand rôle dans cette prise de conscience. Ainsi, Alberto Acosta, ancien président du Conseil constitutionnel en Équateur, a publié une déclaration sur la Nature comme sujet de droit. Les mouvements amazoniens ont rappelé que la destruction environnementale rapporte beaucoup à une petite minorité, mais coûte cher à la société et à la planète. Tous les grands projets sont confrontés à des problèmes écologiques : la déforestation, les agrocarburants, les canaux et barrages en Amazonie, les droits sur les terres des peuples indigènes et des descendants africains…
Le débat sur les options techniques et les différents choix possibles rebondit sur celui sur la nature de la croissance économique. La question des inégalités est présente dans ces débats par plusieurs aspects. Entre les pays, à travers notamment la notion de dette écologique. Mais aussi dans l’articulation entre les inégalités sociales et les inégalités écologiques, qui amène à rediscuter de la définition des richesses et de leur répartition et à préciser la question des « biens communs ». Le débat sur les mobilisations écologistes mené à l’occasion du Sommet de Copenhague va s’accentuer avec la préparation de la COP21. Dans la durée, seule la mobilisation et la détermination des mouvements, leur capacité à lier les propositions aux résistances, peut conduire à modifier durablement les politiques.
Penser la transition
Pour penser la transition, il faut apprécier les avenirs possibles. La crise structurelle porte la confrontation entre plusieurs avenirs possibles, entre plusieurs visions du monde. La stratégie des mouvements se définit par rapport aux avenirs possibles et aux conceptions qui les sous-tendent. Ils ont été précisés dans les débats du Sommet des peuples qui a été organisé par les mouvements sociaux en contrepoint de la Conférence des chefs d’État « Rio+20 », en juin 2012. Trois horizons, trois conceptions, peuvent être dégagés : le renforcement sous d’autres formes de la financiarisation et son extension à la Nature ; un réaménagement du capitalisme fondé sur une régulation publique et une modernisation sociale ; une rupture ouvrant sur une transition écologique, sociale et démocratique. Les situations concrètes sont caractérisées, dès maintenant, par des articulations spécifiques entre ces trois logiques.
La première conception, celle du renforcement du néolibéralisme, est celle de la financiarisation de la Nature. Elle a été exposée dans le document de travail préparé par les Nations unies pour Rio+20. Dans cette vision, la sortie de la crise passe par le « marché illimité » nécessaire à la croissance. Elle fonde l’élargissement du marché mondial, qualifié de marché vert, sur la financiarisation de la Nature, la marchandisation du vivant et la généralisation des privatisations. Cette approche reconnaît que la Nature produit des services essentiels (elle capte le carbone, elle purifie l’eau, etc.). Mais elle considère que ces services sont dégradés parce qu’ils sont gratuits. Pour les améliorer, il faut les marchandiser et les privatiser. Dans cette optique, seule la propriété privée permettrait une bonne gestion de la Nature qui serait confiée aux grandes entreprises multinationales, financiarisées. Il s’agit alors de restreindre les références aux droits fondamentaux qui pourraient affaiblir la prééminence des marchés. Il s’agit de subordonner le droit international au droit des affaires.
La deuxième conception est celle du Green New Deal, défendue par d’éminents économistes de l’establishment comme Joseph Stiglitz, Paul Krugman et Amartya Sen, souvent qualifiés de néo-keynésiens. Elle part de l’ « économie verte » qu’il s’agit de maîtriser. La proposition est celle d’un réaménagement en profondeur du capitalisme à partir d’une régulation publique internationale et d’une redistribution des revenus. Elle est encore peu audible aujourd’hui car la logique dominante, celle du marché mondial des capitaux, refuse les références keynésiennes et n’est pas prête à accepter qu’une quelconque inflation vienne diminuer la revalorisation des profits. Il faut rappeler que le New Deal adopté en 1933 n’a été appliqué avec succès qu’en 1945, après la Seconde Guerre mondiale.
La troisième conception a été explicitée et portée par des mouvements sociaux et citoyens dans le processus des forums sociaux mondiaux. Ils préconisent une rupture, celle de la transition sociale, écologique et démocratique. Ils mettent en avant de nouvelles conceptions en gestation, de nouvelles manières de produire et de consommer. Citons les biens communs et les nouvelles formes de propriété, la lutte contre le patriarcat, le contrôle de la finance, la sortie du système de la dette, le buen vivir et l’idée que la prospérité n’est pas synonyme de la croissance, la démocratisation radicale de la démocratie, les services publics fondés sur les droits et la gratuité. Il s’agit de fonder l’organisation des sociétés et du monde sur l’accès aux droits pour tous et l’égalité des droits.
L’écologie est présente, omniprésente dans les trois scénarios. Dans le premier cas, il s’agit de poursuivre la conquête et la domestication de la Nature en accentuant la sous-estimation de l’écologie portée par le néolibéralisme. Dans le deuxième cas, l’écologie devient le facteur limitant de la croissance productiviste qui fonde la redistribution. Dans le troisième cas, elle est, dans ses relations avec les autres composantes, un des fondements de la transition.
La stratégie des mouvements est de réunir tous ceux qui refusent la première conception, celle de la financiarisation de la Nature. D’autant que l’imposition du système dominant malgré l’épuisement du néolibéralisme porte les risques d’un néo-conservatisme de guerre. Les mouvements sociaux ne sont pas indifférents aux améliorations en termes d’emploi et de pouvoir d’achat que pourrait apporter le Green New Deal. Mais de nombreux mouvements constatent l’impossibilité de concrétiser cette régulation publique dans les rapports de force actuels. Ils considèrent de plus que la croissance productiviste correspondant à un capitalisme, même régulé, n’échappe pas aux limites de l’écosystème planétaire. Dans la durée, la confrontation positive opposera les tenants du Green New Deal et ceux du dépassement du capitalisme. Les alliances concrètes dépendront des situations des pays et des grandes régions.
Le temps de la transition radicale est un temps long et n’est pas linéaire. C’est une révolution de longue durée qui passe par des moments révolutionnaires et des insurrections populaires, mais qui ne s’y résume pas. Dans une période de transition, deux questions principales se posent : comment passe-t-on d’une période à une autre ? Comment une nouvelle logique systémique apparaît-elle et s’impose-t-elle ?
Les nouveaux rapports sociaux se construisent à partir des résistances et de la contestation, par les luttes contre les rapports dominants, la critique intellectuelle et théorique, les pratiques nouvelles qui préfigurent des dépassements des rapports existants. Le dépassement du capitalisme s’inventera dans la transition. Il réinvestit et réinvente tous les anciens rapports sociaux, y compris les rapports capitalistes. Il se construit par l’invention des nouveaux rapports qui apportent des réponses aux contradictions des rapports existants. Il crée une nouvelle situation, avec ses nouvelles contradictions. Il porte des valeurs et une rationalité nouvelles. C’est la subordination des formes anciennes à cette rationalité nouvelle qui est en œuvre. Les rapports anciens continuent à exister, mais sont transformés.
La pensée écologique participe à l’émergence de nouvelles questions et de nouvelles perspectives. Le temps de l’écologie est un temps très long, un temps quasi géologique. L’espace de l’écologie est l’espace de la planète. Non que les frontières n’aient pas leur importance, y compris l’idée même de frontière. L’écologie ne s’y résume pas et ne s’y inscrit pas. Elle porte une identité planétaire qui vient se rajouter et compléter les autres identités, les identités multiples.
Penser le politique
Le paradigme écologique n’a pas renouvelé fondamentalement le politique, même s’il y contribue par bien des aspects. Les mouvements écologistes sont très présents dans le mouvement altermondialiste et dans le processus des forums sociaux. Le mouvement altermondialiste se construit dans la convergence des mouvements autour de quelques principes, celui de la diversité et de la légitimité de toutes les luttes contre les oppressions, celui de l’orientation stratégique de l’accès aux droits pour tous et de l’égalité des droits, celui d’une nouvelle culture politique qui relie engagement individuel et collectif.
Depuis 2011, des mouvements massifs témoignent de l’exaspération des peuples. Un nouveau cycle de luttes et de révolutions a commencé il y a moins de trois ans à Tunis, s’est étendu à la région, a traversé la Méditerranée et s’est propagé avec les « indignés » en Europe du Sud, en Espagne, au Portugal, en Grèce. Il a trouvé un nouveau souffle en traversant l’Atlantique à travers les « occupy » Wall Street, Montréal. Il a pris des formes plus larges dans de nombreux pays du monde, au Chili, au Canada, au Sénégal, en Croatie, autour de la faillite des systèmes d’éducation et de la généralisation de l’endettement de la jeunesse. Il rebondit à partir des mobilisations en Inde, en Turquie, au Brésil et en Égypte.
Ces mouvements portent explicitement le refus de la misère sociale et des inégalités, le respect des libertés et de la dignité, le rejet des formes de domination. D’un mouvement à l’autre, il y a eu des affinements sur la dénonciation de la corruption ; sur la revendication d’une « démocratie réelle ». Dans ces mouvements, l’écologie n’est pas au centre des revendications, du moins explicitement. Mais elle transparaît à travers de multiples mobilisations autour de l’accaparement des terres, de l’eau, du contrôle des matières premières, des gaz de schiste, du parc Gezi à Istanbul, de l’urbanisme des grands événements… L’écologie apparaît comme un soubassement qui participe à la radicalisation de l’ensemble des mobilisations. Le passage de l’écologie de la dimension cachée à la pleine lumière s’inscrit dans la nouvelle culture politique.
Cette culture enrichit la manière de relier les déterminants des structurations sociales : les classes et les couches sociales, les religions, les références nationales et culturelles, les appartenances de genre et d’âge, les migrations et les diasporas, les territoires. Elle expérimente de nouvelles formes d’organisation à travers la maîtrise des réseaux numériques et sociaux, l’affirmation de l’auto-organisation et de l’horizontalité. Elle tente de redéfinir, dans les différentes situations, des formes d’autonomie entre les mouvements et les instances politiques. Elle recherche des manières de lier l’individuel et le collectif. C’est peut-être à ce niveau que les réseaux sociaux divers portent de nouvelles cultures, à l’instar des collectifs de logiciels libres. La réappropriation de l’espace public est une revendication de souveraineté populaire. Les places renouvellent les agoras. Une large partie de cette culture s’est construite en liaison avec les mouvements écologistes, à partir des remises en cause ouvertes par le paradigme écologiste.
Cette nouvelle culture politique remet en cause la dictature du pouvoir financier et la « démocratie de basse intensité » qui en résulte. La défiance par rapport aux partis et aux formes traditionnelles du politique avait été déjà marquée avec les indignés espagnols (« vous ne nous représentez pas »), les « occupy » (« vous êtes 1 %, nous sommes 99 % »). Cette défiance s’exprime par la condamnation de la corruption systémique. La fusion entre le politique et le financier corrompt structurellement la classe politique dans son ensemble. Le rejet de la corruption va au-delà de la corruption financière ; il s’agit de la corruption politique. Comment faire confiance, quand ce sont les mêmes, avec parfois un autre visage, qui appliquent les mêmes politiques, celles du capitalisme financier ? La subordination du politique au financier a remis en cause l’autonomie de la classe politique.
Ces mouvements sont spontanés, radicaux, hétérogènes. Certains affirment que ces mouvements ont échoué parce qu’ils n’ont pas de perspective ou de stratégie et qu’ils ne se sont pas dotés d’organisation. Cette critique mérite d’être approfondie. Elle n’est pas suffisante quand on sait que le plus vieux d’entre eux a trois ans. Les mouvements ne rejettent pas toutes les formes d’organisation ; ils en expérimentent des nouvelles. Celles-ci ont démontré leur intérêt dans l’organisation des mobilisations, la réactivité aux situations et l’expression de nouveaux impératifs, même si la question des formes d’organisation par rapport au pouvoir n’est pas encore entamée et laisse un goût d’inachevé.
L’affrontement idéologique et la bataille contre l’hégémonie culturelle dominante sont nécessaires et ont connu des succès. Mais ces avancées ne sont pas suffisantes. Elles ne se sont pas traduites politiquement. Les mouvements ne vont pas changer la société sans prendre en compte le politique ; sans poser la question du pouvoir et sans réinventer les formes du politique. La période récente illustre l’importance des approches sur les partis politiques et l’État ; le temps des révolutions et les transitions ; la question démocratique et les élections.
Dans l’interpellation des pouvoirs, le rôle des partis politiques a son importance. L’altermondialisme a défendu la nécessaire indépendance des mouvements par rapport aux partis politiques. Ce qui ne suffit pas pour définir le rapport des mouvements à ces partis. Cette relation se définit concrètement dans les situations qui en caractérisent les opportunités et les contraintes. Les mouvements n’ignorent pas les partis, qui permettent souvent un passage vers des décisions politiques locales, nationales et internationales. Ils travaillent avec les partis sans en devenir les relais. L’autonomie des mouvements n’est pas tactique. Les mouvements participent à la séparation des pouvoirs nécessaire au respect des libertés individuelles et collectives, qui définit une démocratie.
L’intervention de l’écologie sur la scène politique, à travers les partis écologistes, n’a pas convaincu. Ces partis n’ont pas échappé au discrédit du politique, vérifié à travers la notabilisation et les combinaisons tortueuses. Le paradigme écologique n’a pas donné naissance à un nouveau paradigme politique. Le passage du républicanisme au socialisme avait conduit à l’obsolescence des partis républicains. La violente différenciation entre socialisme et communisme s’est vite reflétée dans le champ politique. Depuis 1970, s’est ouverte une période de quarante ans de défaites et de régressions du mouvement social dans les pays décolonisés, dans les pays qui avaient connu des révolutions et dans les pays industrialisés. Toutes les formations de la gauche traditionnelle et de l’extrême gauche apparaissent déclassées par rapport aux demandes et aux situations. L’écologie comme nouveau paradigme ne s’est pas traduite dans de nouvelles propositions politiques. Et ce n’est pas une simple question de temps. L’importance de la dimension écologique s’est imposée. Mais les partis qui s’y réfèrent n’apparaissent, ni dans leurs programmes, ni dans leurs formes d’organisation, porteurs des novations que l’on devrait attendre d’un nouveau paradigme.
C’est à travers la conception du parti politique que se sont historiquement nouées plusieurs questions : celle d’un intellectuel collectif et organique ; le rapport à l’État et aux institutions ; la conquête du pouvoir et son contrôle ; les élections et la démocratie. La déconstruction est nécessaire pour dénouer leurs différentes fonctions. Le défi pour les mouvements est de porter un renouvellement des formes d’organisation par rapport à la capacité de résistance aux classes dominantes, à la maîtrise des affrontements dans les moments de rupture et aux formes de renouvellement du pouvoir et du politique.
Dans ce renouvellement, deux tendances doivent être prises en compte. La première porte sur le désaveu historique des partis et de la forme parti par rapport au dépassement du capitalisme, à la défaite historique du soviétisme, et au rapport au pouvoir et à la transformation de l’État. La seconde porte sur la défiance par rapport au politique et sur le désaveu populaire massif de la classe politique qui est explicité par les nouveaux mouvements.
La question politique, celle du pouvoir, ne passe pas exclusivement par la prise du pouvoir d’État, mais elle ne peut pas s’en désintéresser. Les associations spécialisées dans le politique, les partis politiques, ont concentré leurs efforts sur l’État et les institutions. La question primordiale est celle de la contradiction dialectique de l’État, instrument de la domination de la bourgeoisie et de sa reproduction, mais dans le même temps instrument de l’intérêt général et de la régulation publique et citoyenne. Si l’intervention de l’État reste indispensable, changer la société ne peut pas être confié simplement à l’État, même en faisant l’hypothèse de la révolutionnarisation de celui-ci. Les écologistes ont été vite conscients de l’importance du débat sur l’État, même si leurs critiques les ont parfois amenés à tomber dans une certaine faiblesse pour le marché. On retrouve à ce niveau le débat sur la nature des transitions.
Dans « vous ne nous représentez pas », il y a deux affirmations. La première, c’est la remise en cause de l’oligarchie et de la subordination du politique au financier. La seconde, c’est la remise en cause de la démocratie représentative, et parfois, plus largement, de la représentation. La réinvention de la démocratie passe par plusieurs interrogations ; parmi elles la question des élections, celle de la majorité et de la démocratie mondiale.
Le débat entre démocratie représentative et démocratie directe ne peut se réduire à la démocratie participative. La question des élections n’est pas seulement une question de situations. Comme le dit, avec humour, Immanuel Wallerstein, « 99 %, c’est formidable, mais ça ne suffit pas à faire une majorité ». Mais, il y a aussi une question théorique des élections. Il est difficile d’imaginer une démocratie sans élections, et de nombreux militants se font tuer pour obtenir des élections quand des régimes dictatoriaux les interdisent ou les manipulent. Mais les élections ne suffisent pas à garantir ou même à caractériser la démocratie. Pour qu’un bouleversement porté par des mouvements se traduise par une légitimation électorale, il faut un basculement des idées et des valeurs portées par les batailles idéologiques de long terme.
Au-delà de la nécessaire démocratisation, se pose la question d’une orientation alternative à la mondialisation capitaliste. Elle comporte un enjeu majeur, celui d’une nouvelle phase de la décolonisation qui correspondrait, au-delà de l’indépendance des États, à l’autodétermination des peuples. Elle met sur le devant de la scène les questions de l’épuisement des ressources naturelles, particulièrement de l’eau, du climat, de la biodiversité, du contrôle des matières premières, de l’accaparement des terres. Elle pointe l’indispensable renouvellement culturel et civilisationnel. Les enjeux de la nouvelle révolution se précisent : la définition de nouveaux rapports sociaux et culturels, de nouveaux rapports entre l’espèce humaine et la Nature, la nouvelle phase de la décolonisation et la réinvention de la démocratie.
Quelques références
- Agarwal Anil, Narain Sunita, Towards a greener world. Should global environmental management be built on legal convention or human rights ?, Centre for Science and Environment, New Delhi, 1992
- Arruda Marcos, Échanger nos visions d’une économie responsable, plurielle et solidaire, Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, Brésil, 2008
- Azam Geneviève, le temps du monde fini, vers l’après-capitalisme, Les liens qui libèrent, Paris, 2010,
- Combes Maxime, Bangkok, premier état des négociations sur le climat, notes Attac et Aitec, octobre 2009,
- Coutrot Thomas, Flacher David, Méda Dominique (dir.), Pour en finir avec ce vieux monde. Les chemins de la transition, Ed. Utopia, 2011
- Flipo Fabrice, Nature et politique, contribution à une anthropologie de la modernité et de la globalisation, Ed Amsterdam, 2014
- Gorz André, Leur écologie et la nôtre, Les Temps Modernes, mars 1974
- Harribey Jean-Marie, La richesse, la valeur et l’inestimable, Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste, Ed. Les Liens qui libèrent, Paris 2013.
- Löwy Michael, L’écosocialisme, Ed. Mille et Une Nuits, Paris 2011
- Lipietz Alain, Qu’est-ce que l’écologie politique ? La grande transformation du XXIe siècle, Ed. La Découverte, Paris, 1999 puis 2003
- Massiah Gustave, Ecologie et solidarité international, CRID, Paris 2009
- Raina Vinod, Ecological debt, Alternatives international, Québec, nov. 2009
Gustave Massiah